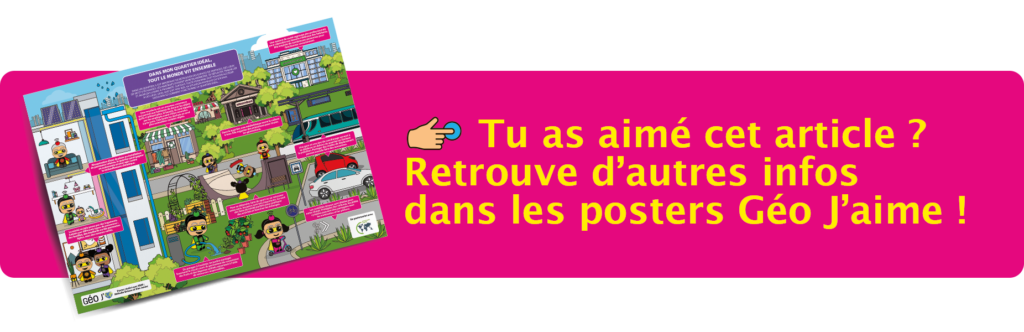À la fin du 19e siècle a lieu la révolution industrielle. Beaucoup de personnes quittent les campagnes pour les villes, et les usines qui embauchent. Il faut donc loger tous ces ouvriers. Quelques industriels construisent des petites villes. À l’époque, elles sont confortables et dotées de services gratuits comme des consultations médicales. Ces cités ouvrières sont surtout pratiques pour les patrons qui logent la main-d’œuvre au plus près des usines. Mais les cités ouvrières restent rares. La plupart du temps, les ouvriers habitent dans des petites maisons en briques alignées. Il n’y a pas encore d’eau courante ni de salle de bain. Ces quartiers sont tentaculaires, sales et peu sûrs. Pas de place pour un parc ou des arbres dans les rues rectilignes. La ville est aussi très polluée par les cheminées d’usines et tout le monde redoute
le retour d’épidémies, comme celle du choléra.
La notion et le mot d’urbanisme apparaissent à cette époque. Il s’agit de réfléchir à l’organisation des espaces et à la gestion des hommes et de leurs activités. Ebenezer Howard est anglais, il fait partie des premiers urbanistes. C’est lui qui invente le concept de cité-jardin. Sa ville idéale est entourée de champs pour nourrir les habitants. Les terrains appartiennent à la ville et le nombre d’habitation est assez faible pour laisser de la place à des parcs, commerces et lieux culturels. C’est aux habitants de décider des activités pratiquées sur son territoire. Enfin, la cité-jardin doit être connectée à d’autres par le train, une des grandes innovations à la base de la révolution industrielle…
En 1903, les grands principes d’Howard sont mis en pratique avec Raymond Unwin et Barry Parker qui construisent au nord de Londres la cité-jardin (Garden City en anglais) de Letchworth. Quelques années plus tard, ce sera au tour de la cité-jardin Welwyn, puis la banlieue jardin d’Hampstead dans un quartier de Londres.


Au début du 20e siècle, de nombreuses cités-jardins ont été bâties en Europe et en Amérique pour accueillir les classes populaires. En France, la première cité-jardin a été construite entre 1904 et 1908 dans le Nord, à Dourges. La cité Bruno de Boisgelin (du nom du président de la compagnie des Mines) compte environ 500 pavillons identiques, avec un jardinet devant et un potager derrière.
Lyon, Reims, Strasbourg, Limoges… Si de nombreuses villes de France ont aujourd’hui un quartier issu d’une cité-jardin, c’est en région parisienne qu’il y en a le plus. L’office des Habitations à Bon Marché de la Seine a réalisé une quinzaine d’ensembles. Utopique et social, le modèle évolue au fil des années, avec une répartition différente des espaces verts, concentrés à un seul endroit par exemple une grande pelouse centrale. Les pavillons ont aussi fait place à des immeubles. Certains de ces ensembles existent toujours et sont habités. Ils sont souvent classés au patrimoine historique !
Le mouvement s’est arrêté pour des raisons politiques. Après la Seconde guerre mondiale, les architectes et urbanistes ont privilégié d’autres constructions, comme les tours. Le concept réapparait depuis une vingtaine d’années sous d’autres formes. De nouveaux écoquartiers sont proposés avec des rues-jardins, des potagers collectifs, des fermes urbaines… Les enjeux environnementaux se doublent des envies de citadins. Avec les confinements liés à la Covid-19, ils rêvent d’espace et de nature !